Recherche : 7 contrats doctoraux cofinancés par SPECTRUM
- Recherche
- Partenariats
- Innovation
du 24 juillet 2025 au 31 octobre 2025
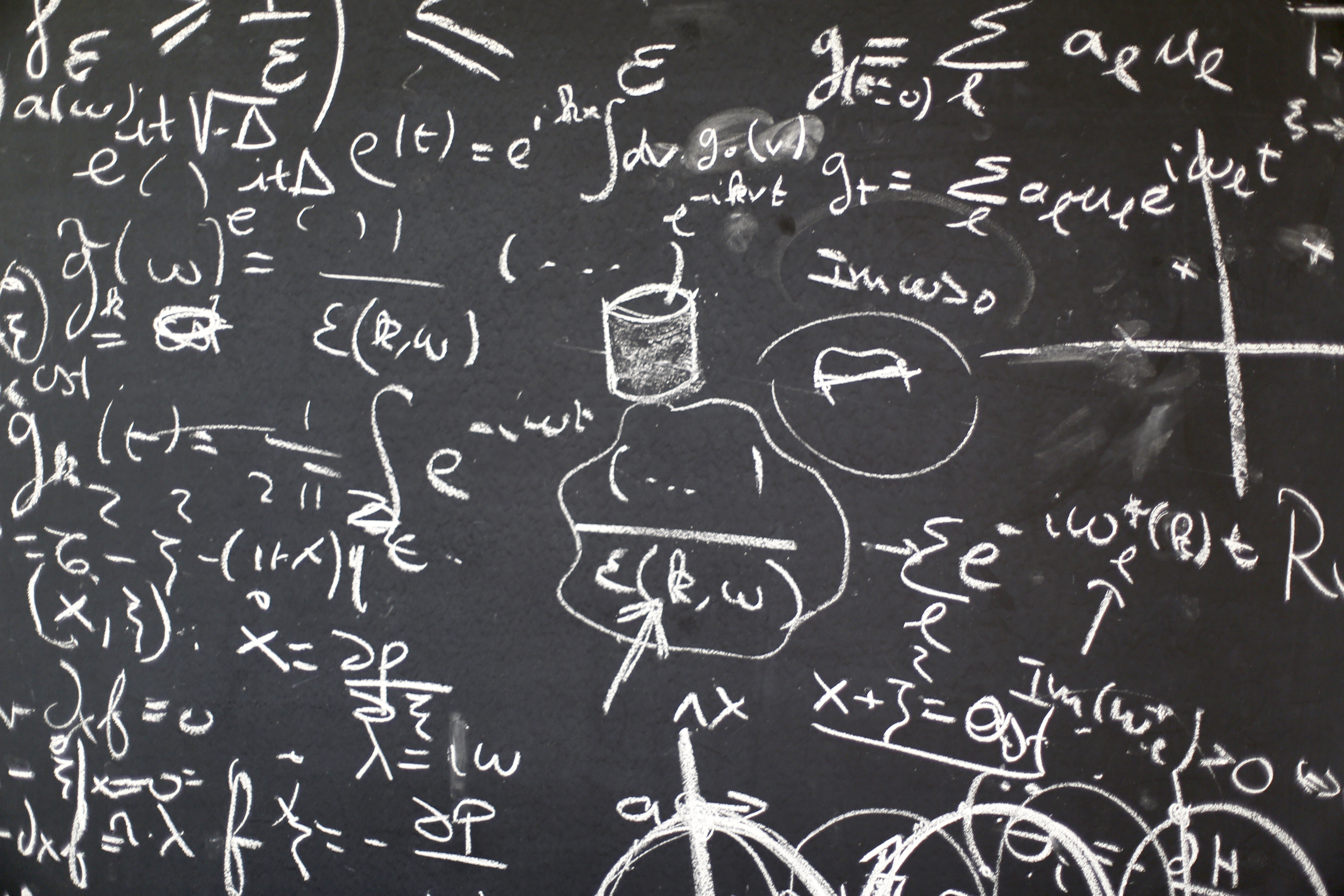
L’École Universitaire de Recherche SPECTRUM, spécialisée en sciences fondamentales et ingénierie à Université Côte d’Azur, finance chaque année, en partenariat, plusieurs contrats doctoraux d’une durée de trois ans. Découvrez les doctorantes et doctorants sélectionnés pour l’année 2025 !
Grâce à l’expertise reconnue de ses enseignants-chercheurs et chercheurs, SPECTRUM – l’école universitaire de recherche dédiée aux sciences fondamentales et à l’ingénierie – soutient les doctorantes et doctorants dans leurs projets scientifiques, au sein des laboratoires d’Université Côte d’Azur.
En 2025, ce soutien se concrétise par le cofinancement de sept contrats doctoraux de trois ans, dont un projet centré sur les technologies quantiques, financé dans le cadre du programme QuanteDu France porté par l’Institut Quantazur.
Doctorants et doctorantes sélectionnés pour une bourse de thèse
Laurine Andres – Laboratoire Géoazur (Géosciences)
Projet : LIDO - Passive Acoustic Monitoring of Cetaceans and their Environment in the Pelagos Sanctuary Using the LigurianSea DAS Observatory - co financé avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)Le projet LIDO propose de révolutionner la surveillance des cétacés dans le sanctuaire Pelagos en Méditerranée, en s’appuyant sur une technologie innovante : la detection acoustique distribuée (DAS). Alors que les méthodes traditionnelles de surveillance peinent à fournir une couverture spatiale et temporelle nécessaire, le projet LIDO propose de mettre en place une écoute continue et haute résolution des mammifères marins.
- En savoir plus
-
Ecouter les cétacés grâce à un câble de télécommunication sous-marinPour y parvenir, un ancien câble de télécommunication sous-marin long de 160km entre Monaco et Savone est transformé en réseau de capteurs acoustiques virtuels denses (Sladen et al., 2019). Déjà éprouvée, la technologie DAS appliquée à ce câble a détecté les vocalisations des rorquals communs et le trafic maritime en temps réel avec une précision sans précédent (l'équivalent de 8 000 capteurs virtuels espacés tous les 20 m).
Le projet LIDO prévoit également d’étudier l’écologie comportementale et les vulnérabilités potentielles des cétacés (Paoletti et al., 2023). Pour comprendre comment ces mammifères marins réagissent aux facteurs environnementaux (trafic maritime, changements de température, événements sismiques), l’infrastructure sera couplée à des données environnementales pour révéler où les cétacés sont présents ainsi que les facteurs qui influencent leur répartition et leur abondance.
Ce travail doctoral sera porté par Laurine Andrès, ingénieure diplômée de Ecole Nationale de Géologie de Nancy (ENSG) en 2024, spécialisée en Géologie numérique et théorie de la propagation des ondes. Laurine est déjà investie dans le laboratoire Géoazur depuis plus de 6 mois. Elle sera encadrée par Anthony Sladen, chercheur CNRS en géophysique, et actuellement responsable du projet ANR « SEAFOOD » visant à développer une instrumentation des fonds marins dense, basée sur des câbles à fibres optiques.Un consortium interdisciplinaire d’experts mobilisés
Pour mener ce projet, un consortium interdisciplinaire d’experts sera également mobilisé :
- Paul Cristini du Laboratoire de Mécanique Acoustique, Marseille (LMA) qui apportera son expertise pour la génération de modélisations complexes de la propagation des ondes en 2D/3D.
- Le professeur Cédric Richard du Laboratoire Lagrange (Université Côte d'Azur - OCA - CNRS), expert en traitement statistique du signal et en apprentissage automatique.
- Léa Bouffaut (Université Cornell), experte en bioacoustique, notamment en interprétation des signaux des mammifères marins.
- Le professeur Martin Landrø (Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU), expert en géophysique marine.
Et le soutien de deux partenaires clés :
- Simone Panigada, directrice de l'Institut de recherche Téthys. Ils fourniront des données provenant de cétacés équipés de balises GPS, facilitant ainsi la validation et l'étalonnage des méthodes de surveillance.
- L'ONG ACCOBAMS, basée à Monaco cette organisation intergouvernementale se consacre à la conservation des cétacés en Méditerranée et dans les mers adjacentes.
Augustin Puel – Laboratoire J-A Dieudonné (Mathématiques et Interactions)
Projet : Statistical inference for Interacting Particle Systems driven by a fractional Brownian motion (SIPS-fBm) : cofinancé avec Centrale MéditerranéeLe projet SIPS-fBm explore un champ de recherche émergent à l’intersection des mathématiques appliquées, de la modélisation stochastique et des sciences computationnelles.
Plus précisément, il vise à développer un cadre statistique novateur pour des particules en interactions (SPI), pilotées par des équations différentielles stochastiques (EDS) permettant de modéliser des trajectoires aléatoires (ex : cours de bourse). Pour ces trajectoires, le bruit aléatoire (ou fluctuations des données) est remplacé par un mouvement brownien fractionnaire (fBm).
- En savoir plus
-
Un modèle pour les systèmes à mémoireContrairement au mouvement brownien classique, le fBm permet d’introduire des effets de mémoire dans les systèmes modélisés, en capturant des dépendances temporelles de long terme.
Objectif de la thèse
Pour ce projet, le principal défi réside dans la nouveauté du sujet : poser les fondements de l'inférence statistique pour les systèmes de particules en interaction pilotés par le mouvement brownien fractionnaire. Il s’agira aussi de développer des outils computationnels pour simuler et estimer ces modèles puis explorer des applications concrètes.
Une collaboration européenne
La thèse portée par Augustin Puel sera encadrée par Radomyra Shevchenko (Centrale Méditerranée) et réalisée en collaboration avec Chiara Amorino de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Ensemble, ils analyseront les équations différentielles stochastiques (EDS), développeront leur approximation via les systèmes de particules (SPI) et proposeront des approches statistiques et développement numériques adaptés.
Au-delà des avancées théoriques, les modèles développés dans cette thèse pourraient à terme être des candidats naturels pour décrire des systèmes complexes avec mémoire, en particulier dans des développements industriels ou technologiques innovants telle que la dynamique des fluides.
Aglind Reka – Laboratoire GEOAZUR (Géosciences)
Projet : Saving Lives with AI: Skeleton Analysis for Person-in-Danger Detection in Drone Videos, Images, aNd Ground Cameras– cofinancé avec Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du PEPR Risques Risques (IRIMA France 2030)Lorsqu'une catastrophe naturelle ou humaine survient, il est crucial pour les services de secours de localiser rapidement les personnes blessées ou en danger. Le projet AI_SAVING propose de développer un système embarqué d’IA sur des drones, capable d’identifier et de décrire automatiquement en temps réel les corps et les comportements de personnes vulnérables dans des zones sinistrées.
- En savoir plus
-
Les survols d’une zone sinistrée par drone sont précieux. Ils fournissent des images et des vidéos des lieux et des personnes touchées par la catastrophe. Pour analysées en temps réel ces données, un nouveau pipeline d'IA sera développé en 2 temps permettant d’identifier et de localiser automatiquement les personnes les plus touchées ou vulnérables, nécessitant des secours prioritaires.Etapes de la conception du pipeline d'IA
Dans un premier temps, un modèle léger de reconnaissance d'actions sera utilisé et entrainé pour reconnaître les corps humains dans les données images/vidéos. Pour y parvenir, il s’agira de comprendre les actions révélées par l'attitude du squelette par une technique de simplification appelée, squelettisation. Cette technique identifie les points clés du corps humain, tels que la tête, les épaules et les relie par des lignes, créant ainsi le squelette de la personne. Elle permet de réduire les images complexes, haute résolution et lourdes en lignes 2D légères ou en nuages de points 3D. Ce modèle léger sera par la suite installé dans le drone.
Dans un deuxième temps, un modèle plus approfondi ou modèle de base appelé « T-MOR » sera construit en cas de détection suspecte. T-MOR reconnaîtra non seulement les corps humains dans les données image/vidéo, mais identifiera également les attitudes corporelles témoignant d'une situation vulnérable. Pour entraîner le modèle « T-MOR », un nouveau grand ensemble de données appelé Skeletics sera créée. Il inclura des données squelettées (corps humains squelettisés), des images RVB (images optiques représentant des humains) et des textes (descriptions textuelles) de personnes observées lors d'une catastrophe, collectés à partir de sources publiques.Un système d’IA embarqué sur drone
En situation réelle, le pipeline fonctionnera ainsi à bord du drone. Le modèle léger analysera rapidement les images et vidéos acquises et détectera les situations potentielles de détresse humaine. Si le modèle identifie une personne en danger ou demandant de l'aide, le système embarqué enverra l'intégralité des données vidéos/images correspondantes au cloud, où le modèle T-MOR effectuera une analyse plus approfondie. Cette analyse vérifiera si la situation nécessite réellement une assistance. Si le système confirme, une alerte sera envoyée aux secours, pour qu’ils puissent évaluer la situation et décider du type d'aide à envoyer et de la manière d'intervenir.
Ce travail de recherche doctorale est mené par M. Aglind Reka, diplômé major de sa promotion d’un Master en Sciences de la Donnée et Intelligence Artificielle à Université Côte d’Azur en Septembre 2024 sous la direction de François Bremond.Un projet intégré dans une stratégie nationale
Le projet AI_SAVING s'inscrit dans le vaste projet intitulé Intelligent_Mapping, lui-même intégré au projet PEPR IRIMA, financé en 2022 par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du PIA4 France 2030. L'objectif principal d'Intelligent_Mapping est de développer des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) pour automatiser, à partir d'images aériennes et satellitaires de la Terre, l'identification, la cartographie, la spatialisation et la mesure des aléas et risques naturels et socio-environnementaux étudiés dans IRIMA (séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, glissements de terrain, inondations, feux de forêt, etc.).
Thomas DYER - Laboratoire Lagrange (Astrophysique)
Projet : Révéler la nature des lunes martiennes et des astéroïdes géocroiseurs grâce à la modélisation thermophysique avancée et aux données des missions spatiales – cofinancé avec CNESCe projet de recherche s'inscrit dans les grandes priorités spatiales françaises et européennes en matière de défense planétaire. Il vise à répondre à des questions fondamentales sur la nature des petits corps du système solaire, en lien avec deux missions spatiales. La mission Martian Moons eXploration (MMX) de la JAXA, qui prévoit de rapporter des échantillons des lunes de Mars et la mission NEOMIR de l’ESA, visant à détecter les astéroïdes dangereux se dirigeant vers la Terre.
- En savoir plus
-
L’évènement de Tcheliabinsk de 2013, où un astéroïde d'environ 20 mètres est entré dans l'atmosphère terrestre sans être détecté car arrivé du côté du ciel exposé au Soleil, a révélé une vulnérabilité majeure. Il a mis en évidence notre lacune à surveiller l’espace proche dans toutes les directions. Pour identifier les astéroïdes, même à des angles de phase élevés, NEOMIR, une mission infrarouge proposée par l'ESA, vise à combler cette déficience. Il s’agit de positionner le télescope spatial NEOMIR au point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil, afin d’être en capacité de détecter des astéroïdes s'approchant de la Terre (appelés impacteurs potentiels imminents) depuis la direction du Soleil, un angle mort d'observation pour les systèmes terrestres.Un enjeu de défense planétaire
Ce projet de doctorat propose une double approche : analyser les données spectroscopiques et thermiques infrarouges des lunes de Mars - Phobos et Deimos - à l’aide de deux instruments embarqués sur la mission Martian Moons eXploration (MMX). Il s’agit des instruments MIRS et miniRAD qui contribueront à déterminer la composition de la surface de ces lunes, leurs propriétés thermiques et la structure du régolithe L’objectif ? Trancher sur la question de l’origine des lunes : fragments martiens ou fragments d’astéroïdes ?
En parallèle, des modèles thermophysiques de nouvelle génération seront développés pour simuler et interpréter les flux infrarouges thermiques des astéroïdes impactant la Terre, en particulier dans les géométries extrêmes, comme celles qui seront couvertes par NEOMIR. Ces modèles permettront de mieux caractériser leur taille, composition et trajectoire d’impacteurs potentiels imminents.
Pour mener ce travail doctoral, Thomas Dyer, sera encadré par Marco Delbo, spécialiste reconnu en modélisation et observation des astéroïdes dans l’infrarouge thermique. Le doctorant travaillera en étroite collaboration avec Thales Alenia Space (Cannes, France), impliqué dans la conception des instruments et l’évaluation de leurs performances.Un projet stratégique pour la France et l’Europe
Ce projet à l’interface de l'astronomie, la géologie planétaire et l'ingénierie spatiale s’inscrit dans la dynamique d’adhésion récente de la France au programme optionnel « Planetary Defense » de l’ESA. Il contribuera à accompagner deux missions spatiales majeures visant un objectif commun : extraire des informations physiques et compositionnelles fiables à partir des données spatiales infrarouges, pour élucider l’histoire des lunes de Mars et à améliorer notre réponse aux menaces astéroïdes.
Karen Trevia-Gonzales - Institut de Physique de Nice
Projet : Tri par friction d'objets biomimétiques mous dans des dispositifs microfluidiques (SoftSorting) - cofinancé avec l’Agence Nationale de Recherche dans le cadre du projet AGDSLes systèmes microfluidiques offre une technique reposant sur la manipulation des fluides à l’échelle micrométrique pour réaliser notamment des laboratoires miniaturisés d’environ 1 centimètre. Ces laboratoires sur puces (lab on chip) permettent de faire des analyses très rapides avec un minimum de réactifs. Le projet SoftSorting propose de développer un nouveau dispositif microfluidique. L’objectif ? Trier des objets mous, tels que des capsules modèles et, à terme, des cellules biologiques. Cette technologie de tri efficace, passif, via des microcanaux texturés ouvre des perspectives prometteuses pour le diagnostic biomédical.
- En savoir plus
-
Un enjeu pour la santéPour y parvenir, ce projet de recherche débutera par des expériences de tri sur deux types de capsules (rigides vs. souples), afin d'observer des effets collectifs tels que les perturbations de trajectoire, les réductions de l'efficacité de déviation et un éventuel regroupement. D'après les résultats dans des écoulements dilués, il est attendu que les capsules les moins déformables soient davantage déviées latéralement, contrairement aux capsules les plus souples poursuivant leur mouvement dans la direction principale de l'écoulement.
Dans un deuxième temps et pour contourner des coûts de simulation directe, un modèle de simulation particulaire basé sur la physique s’appuyant sur des règles de transport efficaces dérivée des expériences précédentes sera conçu. Il prendra en compte la déformabilité et la vitesse longitudinale dépendant de la vitesse d'écoulement des capsules, ainsi que la texture locale des parois (rugosité et densité), la déformabilité et la concentration locale en particules (tamisage hydrodynamique).
Cette approche permettra la simulation de grandes populations et l'évaluation de paramètres de tri tels que la résolution, les taux d'erreur et le débit dans des conditions réalistes d'écoulement et de concentration. L'objectif ultime est d’optimiser la géométrie des microcanaux pour fournir une plateforme de tri haut débit, sans marquage, avec une résolution ajustable et adaptable à une grande variété d'objets biologiques mous.
Ce projet doctoral sera porté par Karen Trevia-Gonzalez, actuellement en stage de M2 au sein de l’Institut de Physique de Nice, avec une solide compréhension des systèmes et méthodologies expérimentaux. Karen sera encadrée par Ludovic Keiser et Christophe Raufaste, experts en dynamique des fluides aux interfaces déformables. Elle bénéficiera d’un accès complet aux plateformes techniques de l’INPHYNI : la salle blanche pour la microfabrication, des salles de chimie, une plateforme de caractérisation (profilométrie, tomographie à rayons X, MEB atmosphérique), ainsi qu’aux moyens de prototypages rapides situés à l'IMREDD (impression 3D).
Perspectives : prototypage et valorisationA terme, une série de prototypes seront fabriqués à l’Institut de Physique de Nice (INPHYNI) via des techniques de microfabrication (lithographie douce, photolithographie, moulage PDMS, soudage plasma). Chaque prototype testera une configuration optimisée afin de tenir compte des variations potentielles de performances en conditions réelles pour être prêt à la fabrication, avec une complexité limitée. Un brevet sera déposé après validation des performances.
Parallèlement, des discussions avec des entreprises spécialisées en microfluidique et en diagnostic biomédical, telles qu'Eurofins, Horiba, Virbac ou Stilla Technologies, ainsi qu'avec des pôles d'innovation rattachés à Université Côte d'Azur seront engagées. Ces collaborations viseront à étendre la preuve de concept à des applications concrètes et à explorer des possibilités de financement pour candidater à des appels d'offres types EIC Transition pour un transfert et une maturation technologique plus poussés.
Manar Reriouedj – Institut de Physique de Nice
Projet : Réseaux intégrés de nanolasers pour le calcul photonique neuromorphique – cofinancé avec Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)Ce projet de recherche ambitionne d’explorer une nouvelle voie de recherche pour l’IA en s’appuyant sur la photonique. Il vise à développer une plateforme expérimentale basée sur des réseaux de nanolasers à semi-conducteurs capables de reproduire des comportements inspirés du cerveau humain.
- En savoir plus
-
En combinant modélisation théorique, expérimentation avancée et microfabrication, le projet vise à créer des circuits optiques capables de simuler certains aspects du fonctionnement du cerveau humain. Ces systèmes pourraient jouer un rôle clé dans le développement d’une intelligence artificielle photonique, plus rapide et plus économe en énergie que les technologies actuelles.
Pour ce travail doctoral, Manar Reriouedi sera encadré par Pr. Fabrice Raineri, spécialiste en optique non linéaire et en nanotechnologies et Guilhem Madiot, spécialiste en nanophotonique, lasers semi-conducteur et dynamiques non linéaire. Manar sera formé à la photonique expérimentale, à l'optique non linéaire et aux méthodes de simulation, acquérant ainsi une expertise en techniques de nanofabrication. Il sera ainsi en mesure de travailler sur la théorie, les tests expérimentaux et la fabrication de ces réseaux tout en collaborant avec des partenaires industriels tels que Thales Recherche et Technologie et la startup NcodiN qui exploreront des applications pratiques en calcul photonique neuromorphique.
Ce projet de doctorat présente un potentiel important de développements industriels innovants et devrait déboucher sur des publications à fort impact et de futures demandes de bourses européenne de type ERC. Par ailleurs, ce projet devrait donner lieu à des publications dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture (Nature, Physical Review, ACS Photonics, Nano Letters, etc.).
Thomas Oudeville – Laboratoire J-A Dieudonné (Mathématiques et Interactions)
Projet : Study of systems of quantum particles interacting with a complexenvironment – cofinancé via le projet QuanteDuFrance porté par l’Institut QuantazurCe projet de thèse s’intéresse à la dynamique de particules quantiques en interaction avec des environnements complexes, comme ceux contenant des vibrations ou des champs fluctuants (ex : réseaux cristallins, champs électromagnétiques quantiques). Il s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche intitulé MaDynOS, visant à mieux comprendre les systèmes ouverts, c’est-à-dire ceux qui échangent de l’énergie ou de la matière avec leur environnement.
- En savoir plus
-
L’objectif principal est de modéliser puis analyser comment des effets comme la dissipation ou la perte d’énergie apparaissent naturellement dans ces systèmes. La recherche combinera outils mathématiques avancés, simulations numériques et concepts de la physique quantique. Elle débutera avec des systèmes simples (1 ou 2 particules), avant de s’étendre à plusieurs corps, tout en étudiant le rôle des interactions et des rétroactions avec l’environnement. Une outil clé sera le formalisme de Wigner-Moyal, un pont entre la mécanique quantique et la mécanique classique.
Ce travail doctoral sera mené par Thomas Oudeville au Laboratoire des Mathématiques et Interactions J-A Dieudonné sous la direction conjointe de Bruno Marcos, spécialiste de la physique statistique et de systèmes dynamiques à N corps ainsi que de Simona Rota-Nodari, experte en analyse mathématique, en particulier les équations dérivées partielles. Il contribuera à faire dialoguer mathématiciens et physiciens théoriciens, notamment présents au sein de l’Institut Quantazur d’Université Côte d’Azur. Thomas Oudeville participera également à des actions de formations et de vulgarisation scientifiques auprès de scolaire.



